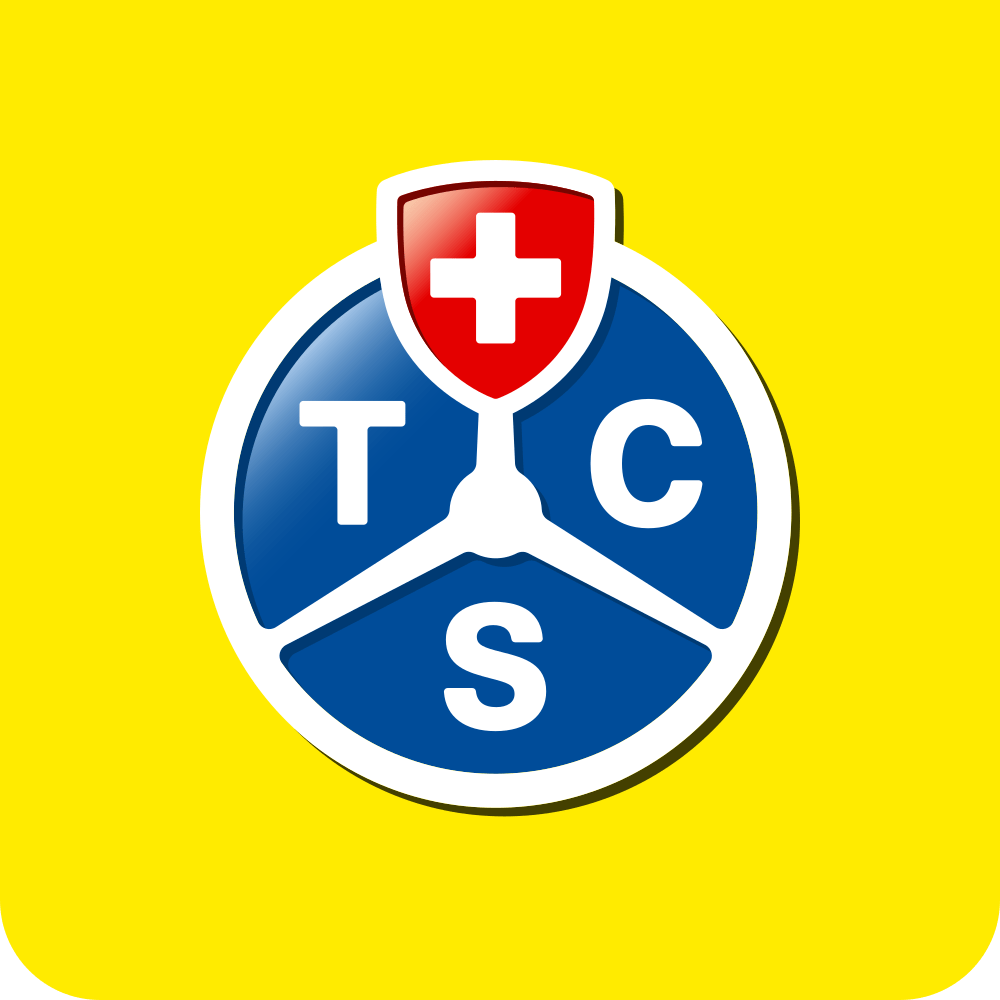Autorités
Une victime de violence domestique peut-elle rester en Suisse après une séparation ?

Une victime de violence domestique conserve son droit de séjour après une séparation. Cela vaut également lorsque l'auteur des violences s'est séparé de la victime.
Par décision du 23 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une étrangère victime de violence est protégée contre l'expulsion même si son partenaire s'est séparé d'elle et non l'inverse. En effet, après la dissolution de la communauté familiale (version en vigueur au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral), une épouse de nationalité étrangère peut rester en Suisse si des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite de son séjour en Suisse. De telles raisons personnelles majeures peuvent résider dans le fait que l'épouse a été victime de violence conjugale. Par cette disposition, le législateur veut éviter qu'une personne victime de violences domestiques reste dans le ménage commun par peur d'être expulsée. La question de savoir de qui émane la volonté de se séparer est tout au plus considérée comme un indice pour l'évaluation de l'exigibilité.
L'Office expulse la victime de violences domestiques
Après son mariage avec un Suisse en février 2014, la ressortissante kosovare obtient une autorisation de séjour. Un an et demi après le mariage, le mari se sépare de sa femme. En juillet 2016, l'Office des migrations expulse la Kosovare de Suisse. Sans clarifier s'il y a eu des violences domestiques, les instances de recours cantonales confirment la décision d'expulsion.
La femme forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci renvoie l'affaire au tribunal cantonal et l'oblige à déterminer s'il y a eu violence conjugale. Le tribunal cantonal constate alors que la femme a été victime de violence domestique. Son ex-mari lui avait scotché la bouche, l'avait frappée, lui avait planté une fourchette dans la cuisse gauche, lui avait écrasé un gobelet en métal sur la tête, lui avait bleui la jambe et l'avait emmenée à plusieurs reprises contre son gré chez ses beaux-parents, en la tirant au besoin de force par les cheveux dans la voiture. Cependant, étant donné que ce n'est pas la femme qui s'est séparée de son mari, mais l'inverse, la cohabitation conjugale était raisonnable et la décision d'expulsion devait donc être confirmée.
Contre cette nouvelle décision d'expulsion, la femme fait un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
Les migrantes victimes de violence protégées indépendamment de leur volonté de se séparer
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'octroi d'un droit de séjour aux victimes de violences conjugales doit empêcher qu'une personne victime de violences conjugales ne reste dans une communauté conjugale objectivement intolérable pour elle, uniquement parce que la séparation entraînerait pour elle des conséquences négatives en matière de droit des étrangers. Selon le Tribunal fédéral, la personne à l'origine de la séparation peut tout au plus constituer un indice de ce qui est raisonnablement exigible. Dans le cas présent, le lien entre la séparation et la violence conjugale est clair : le fait que le mari violent ait d'abord pris la décision de mettre fin au mariage ne change rien au fait que, compte tenu de la violence conjugale persistante, il aurait été objectivement intolérable pour la recourante de rester dans le mariage et qu'elle a donc droit à la prolongation de son autorisation de séjour, déclare le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne à l'Office des migrations de prolonger l'autorisation de séjour. Il oblige en outre le canton de Lucerne à verser à la plaignante un dépens de 2’000 CHF.
Le Parlement renforce la protection des femmes migrantes
La version de l'article du droit des étrangers en vigueur au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral posait des obstacles importants pour prouver la violence domestique. Le 14 juin 2024, le Parlement a adapté la réglementation de la « dissolution de la famille » et a donné aux personnes victimes de violence davantage de possibilités de prouver les délits. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les autorités doivent par exemple tenir compte des confirmations des services spécialisés, des rapports médicaux, des plaintes et condamnations pénales et d'autres preuves pour établir les faits.
Mis à jour le 1er janvier 2025